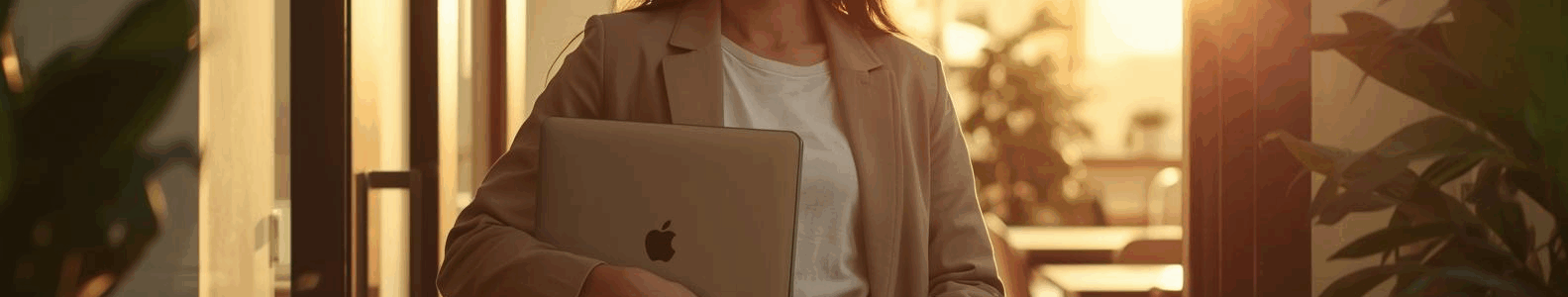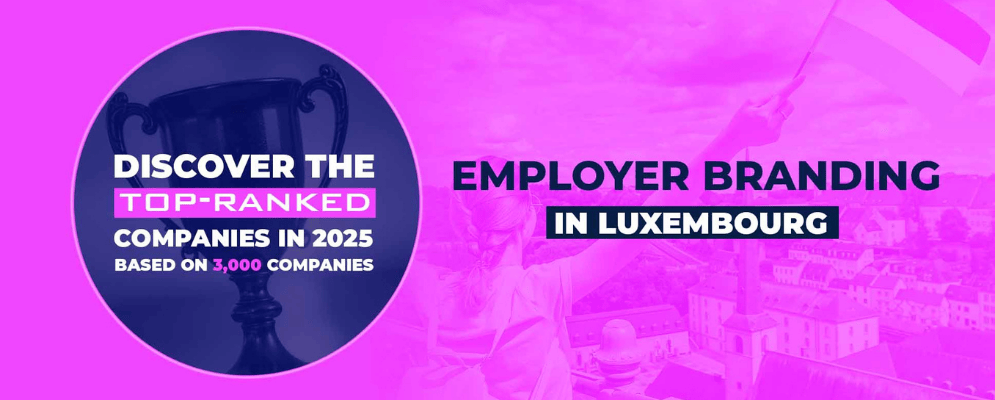Le droit à la déconnexion permet aux travailleurs de ne pas être sollicités ou de ne pas être connectés aux outils numériques en dehors de leur temps de travail, afin de protéger leur temps de repos et préserver leur santé physique et mentale.
En France
Le droit à la déconnexion a été introduit dans le Code du travail par la loi Travail du 8 août 2016. En effet, l’article L2242-8 du code du travail impose aux employeurs de négocier tous les ans sur la qualité de vie au travail, en évoquant notamment le thème du droit à la déconnexion. En l’absence d’accord conclu, l’employeur devra alors établir une charte précisant les modes de régulation de l’usage des outils informatiques, et comment l’entreprise abordera la sensibilisation à l’usage raisonnable et les formations à ces outils.
Les entreprises doivent donc mettre en place des dispositifs afin de réguler l’utilisation des outils numériques, ce qui peut se concrétiser par des journées sans courriels ou encore la remise du matériel informatique en fin de journée ou avant un départ en congé.
En cas de non-respect de cette obligation, il n’existe pas de sanction pécuniaire directe, mais l’employeur s’expose à voir sa responsabilité engagée en cas d’atteinte à la santé du salarié ou d’abus.
En Allemagne
En Allemagne, le droit du travail garantit aux travailleurs des temps de travail maximaux (« Arbeitszeitgesetz ») et des temps de repos (« Ruhezeiten »), mais il n’existe à ce jour aucune législation concernant explicitement le droit à la déconnexion.
Pour autant, certains groupes tels que Volkswagen, BMW ou Daimler ont pris les devants afin de mettre en place des mesures protégeant les salariés d’une « connexion permanente ». Pour le moment, la mise en place de mesures concrètes garantissant la déconnexion des salariés repose donc sur le volontariat des entreprises de conclure ou non des accords volontaires d’entreprise, ou de contractualiser un tel droit
Au Luxembourg
En droit du travail luxembourgeois, le droit à la déconnexion a été consacré par une loi du 28 juin 2023, modifiant ainsi le code du travail en ajoutant la section « Le respect du droit à la déconnexion » au sein du chapitre « Obligations des employeurs ».
Cette nouvelle loi oblige l’employeur à définir, au niveau de l’entreprise ou du secteur, par convention ou accord, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion des salariés en dehors du temps de travail. Ce régime doit comporter des mesures concrètes et des modalités pratiques de mise en œuvre. A défaut de convention, ce régime est à définir directement au niveau de l’entreprise.
Concrètement, il peut comprendre des mesures de déconnexion des appareils informatiques, des sensibilisations et formations, et une éventuelle compensation en cas de dérogation exceptionnelle au dispositif.
En cas de non-respect, l’employeur peut se voir infliger une amende administrative allant de 251 à 25 000 euros par l’inspection du travail et des mines (ITM).
En Belgique
Le droit à la déconnexion en Belgique découle directement de la loi du 16 mars 1971, qui impose le respect des horaires et de la durée du travail.
La loi « Deal pour l’emploi » du 10 novembre 2022 a introduite, pour les entreprises de 20 salariés ou plus, l’obligation, soit par le biais d’une convention collective de travail, soit par le règlement de travail, de définir des modalités de non-joignabilité hors horaire de travail. Ces modalités doivent concrétiser l‘application de ce droit dans l’entreprise et peuvent notamment comprendre des consignes d’usage des outils numériques, et le recours à des formations et actions de sensibilisation quant aux risques liés à la connexion excessive.
Il existe donc bien en Belgique un droit à la déconnexion, mais son effectivité dépend fortement de la faculté à parvenir à une convention sur ce thème, ou de la mise en œuvre réelle des dispositions du règlement de travail dans l’entreprise.
En cas de non-respect de cette obligation, l’employeur ne s’expose pas à une sanction pécuniaire directe, mais sa responsabilité peut éventuellement être engagée. Il risque également une amende pour non-respect des obligations de prévention et de bien-être au travail, si une telle infraction est constatée par le Contrôle des lois sociales ou par l’Inspection du travail.