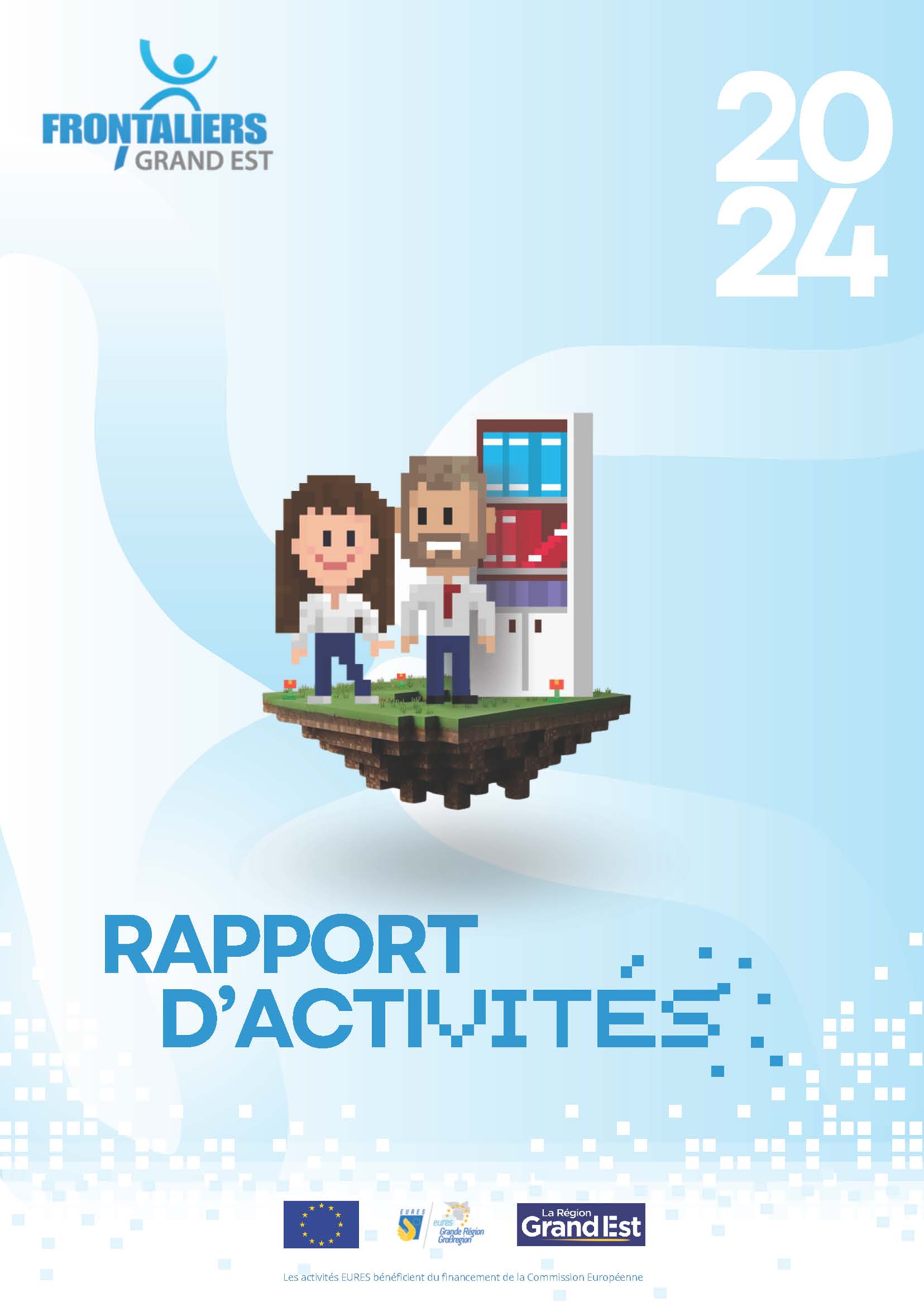Droit aux congés
Un salarié qui travaille au Luxembourg a droit à 26 jours de congé par an.
Si le contrat commence en cours d’année, le congé est calculé au prorata : 2,17 jours par mois complet de travail. Un mois est compté comme complet si le salarié a travaillé plus de 15 jours calendaires.
Enfin, une semaine de congé ne peut compter que pour 5 jours, même si le salarié travaille plus de 5 jours par semaine.
En cas de nouvelle embauche, le salarié acquiert le droit aux congés après avoir effectué trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur, sauf exceptions, notamment si le contrat se termine en cours d’année.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle, notamment avec l’accord de l’employeur.
Fixation de la date de congés
En principe, les dates de congé sont fixées en tenant compte des préférences du salarié. Toutefois, les besoins du service ou les souhaits justifiés d’autres salariés de l’entreprise peuvent s’y opposer, ce qui peut limiter la liberté du salarié dans le choix de ses dates de congé.
Exemple : dans certaines entreprises, la priorité est accordée aux personnes ayant des enfants à charge.
Si le salarié en fait la demande, pour permettre une bonne organisation, le congé annuel doit être fixé au moins 1 mois à l’avance.
Report à l’année suivante
En principe, l’employeur doit accorder le congé annuel et le salarié est tenu de le prendre intégralement au cours de l’année civile.
Cependant, le congé annuel peut être reporté dans différents cas :
- Lorsque les congés ont été acquis au cours de la première année d’emploi et n’ont pas pu être entièrement pris, le salarié peut les reporter jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
- Si, pour des raisons liées aux exigences du service ou aux demandes justifiées d’autres collaborateurs, le salarié n’a pas pu prendre ses congés, ceux-ci peuvent être reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
- Les jours de congé non utilisés au moment du départ en congé maternité, congé d’accueil ou congé parental peuvent également être reportés jusqu’à la fin de la période de report. Ce report peut être prolongé au-delà de cette échéance si le salarié se trouvait dans l’impossibilité de prendre ses congés avant la fin de ladite période.
- En cas d’incapacité de travail (maladie, accident du travail, maladie professionnelle) empêchant la prise des congés, leur report est possible après la reprise effective de l’activité. Toutefois, ce report n’est pas illimité : les congés doivent en principe être pris avant le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis.
L’employeur peut aussi offrir plus de flexibilité pour le report des congés.
Par exemple, il peut permettre de garder les jours non pris d’une année sur l’autre sans limite, ou proposer un système comme un compte épargne-temps.
Congés collectifs
Lorsque l’entreprise ferme pour congés annuels collectifs, la période de ces congés doit être définie en concertation avec la délégation du personnel ou, à défaut, directement avec les salariés concernés.
L’employeur est tenu de communiquer aux salariés la période retenue au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année.
Lorsque la période de congé collectif dépasse la durée du congé annuel payé auquel le salarié peut prétendre, l’excédent lui est accordé sous forme de congé légal. Autrement dit, ces jours sont comptabilisés comme faisant partie du congé légal payé, même si le salarié n’a pas encore acquis suffisamment de jours à ce moment-là.
Par ailleurs, certains domaines et professionnels sont soumis à des congés annuels collectifs d’été et/ ou d’hiver. C’est notamment le cas pour les professions du secteur du bâtiment et du génie civil, les professions de plafonneurs-façadiers ainsi que professionnels d’installateurs sanitaires, installeurs de chauffage et de climatisation et installateurs frigoristes.
Indemnité de congé
Pendant sa période de congé annuel payé, le salarié continue de percevoir sa rémunération.
L’indemnité versée pendant le congé est basée sur une moyenne du salaire habituel du salarié, généralement les revenus perçus au cours des trois mois précédant le départ en congé. Ce calcul prend en compte non seulement le salaire de base, mais aussi les heures supplémentaires effectuées ainsi que les primes accessoires régulières.
Maladie et congé
Le maintien de l’acquisition des congés durant l’arrêt maladie
Les journées durant lesquelles le salarié est absent pour cause de maladie sont assimilées à des jours de travail effectifs au regard du droit aux congés. Cela signifie que même en cas d’arrêt maladie, le salarié continue d’acquérir ses droits à congé annuel de récréation.
Le cas du salarié qui tombe malade durant sa période de congés annuels
Lorsqu’un salarié tombe malade durant sa période de congés annuels, il est impératif qu’il informe rapidement son employeur de cette situation. Cette notification doit s’accompagner d’un certificat médical justifiant son incapacité à travailler. Si le salarié se trouve à son domicile ou en France, il doit transmettre ce document dans un délai de trois jours ouvrables. En revanche, s’il est en déplacement à l’étranger, il doit envoyer ce certificat dans les plus brefs délais, compte tenu des contraintes liées à sa localisation.
Les jours où le salarié est en arrêt maladie (justifié par un certificat médical) ne sont pas comptés comme des jours de congé. Autrement dit, ils ne réduisent pas le nombre de jours de congé auxquels il a droit.
Une fois guéri, le salarié doit reprendre le travail à la date initialement prévue avant son arrêt.
Il devra ensuite, avec son employeur, convenir d’une nouvelle période pour prendre les congés qu’il n’a pas pu utiliser à cause de sa maladie. Cette nouvelle date doit être fixée d’un commun accord, en tenant compte à la fois des besoins de l’entreprise et des souhaits du salarié.